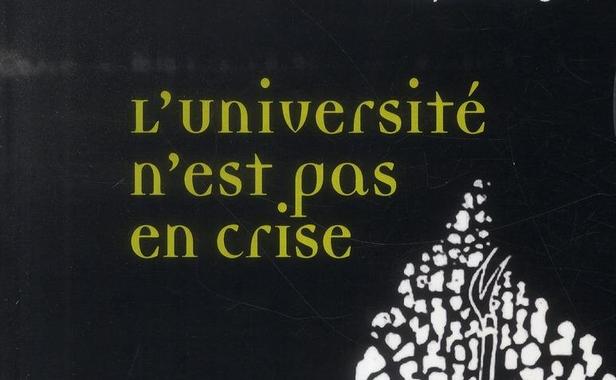 Non, l'université n'est pas en crise
Non, l'université n'est pas en crise
Six idées recues démontées
En introduction, ils annoncent leurs ambitions :
« Il s’agit de faire la critique de ce discours de la crise de l’université et de lui opposer une autre lecture de l’enseignement supérieur. Contre les préjugés et les erreurs qui sont au fondement d’un grand nombre de prises de position, il s’agit de proposer un état des lieux fondé sur les résultats d’enquêtes et d’analyses empiriques. »
Héritiers des sociologues critiques (comme Durkheim et Bourdieu), ils veulent, explique Romuald Bodin, « apporter des éléments objectifs qui vont permettre de mettre en place un débat de nature politique purifié de prénotions, de croyances [des préjugés, ndlr] ».
Les deux sociologues ne sont « pas contre l’usage politique de cet ouvrage », au contraire. Ils présenteront prochainement leurs travaux au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. lls ont par ailleurs échangé avec plusieurs acteurs syndicaux depuis la sortie de leur ouvrage.
Rue89 a lu pour vous leur livre et a inventorié les clichés mis à mal par les deux auteurs.
1
« On va à l’université faute de mieux »
Choisir l’université c’est possible, contrairement au préjugé qui veut que l’on y aille seulement par défaut.
Les deux sociologues se sont intéressés aux étudiants de l’université de Poitiers et ont découvert que, « pour plus des deux tiers des étudiants nouvellement bacheliers », l’université est un choix. Ils avaient mis l’université en premier sur leur liste de vœux en terminale.
Pour les étudiants en bac pro ou techno, l’université n’est pas « l’effet d’une désorientation scolaire » : 42,3% des bacheliers professionnels interrogés en 2006-2007 à Lille-III ont choisi l’université par « envie d’aller à l’université » (33,7% pour la « correspondance avec le projet de formation » et 33,2% pour « l’intérêt pour la discipline »).
2
« Les étudiants n’ont pas de projet professionnel précis »
Les étudiants à l’université ne sont pas là par hasard ou pour passer le temps. Ils ont le plus souvent des projets très précis. Romuald Bodin et Sophie Orange :
« Les données du ministère de l’Enseignement supérieur [PDF] montrent que 88% des étudiants entrés en licence universitaire à la rentrée 2011 ont un projet professionnel, et 44% un projet bien précis. »
Les plus au fait de leur projet ne sont pas ceux que l’on croit, selon leur enquête, menée à l’université de Poitiers :
« Si les étudiants de première année de médecine-pharmacie présentent, de manière assez attendue, une vision précise de leur avenir (54,1%), il est en revanche plus étonnant de trouver, parmi les disciplines affichant les taux les plus élevés d’étudiants bien décidés, la sociologie, la psychologie ou encore l’histoire. »
3
« Les bacs pro et techno envahissent la fac »
Un cliché largement répandu veut que les bacheliers généraux fuient l’université (et préfèrent les filières sélectives) et que les bacheliers professionnels et technologiques « envahissent » les bancs de l’université.
Or :
Conclusion : en 2011, l’université a accueilli 147 794 bacheliers généraux contre seulement 12 099 bacheliers professionnels.
4
« L’université ne forme que des chômeurs »
Il n’y aurait aucun avenir pour les étudiants à l’université. Ce n’est pas vrai.
Les chercheurs rappellent que le diplôme protège face au chômage et ils précisent :
« Les diplômes du supérieur [dont ceux de l’université, ndlr] sont ceux qui s’acquittent le mieux de cette tâche. »
Aller à l’université et obtenir une licence et/ou un master protège mieux du chômage qu’un DUT, un BTS ou encore un CAP, un BEP ou le bac.
Ce qui compte surtout, précisent-ils, ce n’est pas de venir de l’université ou d’une autre formation du supérieur, mais l’état du marché du travail dans le secteur choisi par l’étudiant.
Par exemple (selon les chiffres de l’Insee) :
« Sur la même période, les titulaires d’un master dans le domaine de la communication et de la documentation connaissent 15% de chômage contre 6% pour les “masterisés” en physique et mathématiques. »
Enfin, les sociologues expliquent qu’il faut s’intéresser au taux de chômage à la sortie mais aussi aux chances de devenir cadre ou d’accéder au groupe des professions intermédiaires. Et, dans ce domaine, l’université ne s’en sort pas mal du tout :
« On constate que les masters des universités obtiennent d’aussi bons résultats que les écoles de commerce. »
Cela dépend en revanche de la filière : les masters histoire-géo sont 36% à être devenus cadres ou professions intermédiaires contre 77% des diplômés d’un master en physique-chimie.
5
« Les abandons en fin de première année sont un fléau »
Les deux sociologues rappellent que le phénomène n’est pas nouveau.
« Le phénomène de l’“abandon” existait déjà dans les années 60 et 70 et il se maintient indépendamment des transformations du profil des étudiants. »
En effet, en 2010-2011, sur l’ensemble de la France, seuls 43,1% des étudiants sont entrés en deuxième année à la rentrée suivante. 31,5% ont « abandonné », 25,4% ont redoublé.
Les étudiants à l’université ne sont pas les seuls à abandonner :
Enfin, la première année à l’université sert à certains étudiants de préparation à des formations futures hors université pour lesquelles il n’y a pas de « prépa ».
D’autres partent en BTS, en IUT ou changent de matières à la fac à la fin de la première année. Tous les abandons ne sont donc pas des échecs.
6
« Une sélection à l’entrée serait préférable »
Les auteurs font un constat : sélectionner les étudiants ne veut pas dire attirer un « public d’élite scolaire ».
Parmi les formations qui sélectionnent les étudiants, il y a :
« D’un côté, les écoles de commerce, les écoles d’ingénieurs, les CPGE [classes préparatoires aux grandes écoles, ndlr] [qui] accueillent un faible taux d’étudiants d’origine populaire. De l’autre, les STS, les IFSI [Instituts de formation en soins infirmiers] et les écoles du travail social [qui] se distinguent par une surreprésentation de ces mêmes étudiants. »
Conclusion des sociologues : ce n’est pas le fait de sélectionner qui importe mais la place d’une filière ou d’un établissement dans la « hiérarchie symbolique ».
Plus un établissement est bien considéré, plus il attirera les « meilleurs élèves », c’est-à-dire ceux avec les meilleurs résultats scolaires et venant de la classe supérieure.
L’université se situe au milieu de cette « hiérarchie symbolique ».
« Avec ou sans sélection, l’université restera ce que sa position dans l’espace de l’enseignement supérieur fait d’elle : un sous-espace intermédiaire et différencié où se croisent une élite étudiante relative et des étudiants plus fragiles issus de la massification. »
En son sein :
Une usine à « miracles ordinaires »
Les auteurs concluent :
« L’université est un lieu privilégié de production des miracles ordinaires : le lieu des trajectoires improbables des étudiants d’origine socialement et culturellement défavorisée et/ou de ces bacheliers technologiques, voire professionnels, qui réussissent dans le supérieur. »
Ce ne sont pas des miracles « extraordinaires » (les enfants de classe populaire qui deviennent énarques ou normaliens) mais cela reste des miracles en bonne et due forme.